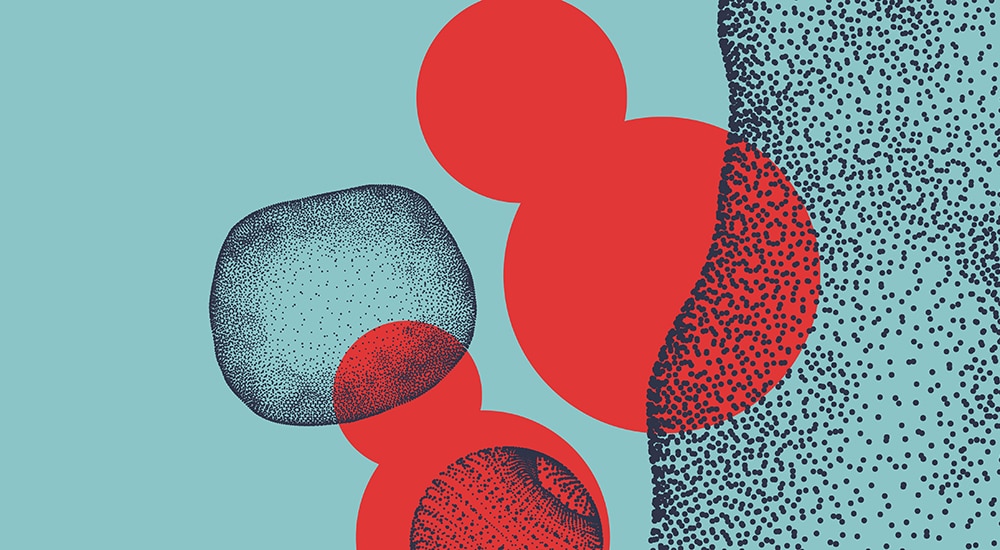PFAS : le point sur les contaminations
L’Anses dresse un état des lieux de la contamination par les PFAS (composés per- et polyfluoroalkylées) et propose des stratégies de surveillance adaptées à ces substances.

Pour la première fois, l’Anses a compilé et exploité les données de contamination disponibles dans l’ensemble des milieux de l’environnement, l’alimentation, les produits de consommation et la biosurveillance, etc. Les PFAS représentent plusieurs milliers de substances pouvant s’accumuler et diffuser dans l’environnement. Leur toxicité est connue de manière parcellaire. Parmi les milliers de composés PFAS, peu d’entre eux sont recherchés et documentés, exception faite des quelques substances intégrées dans les dispositifs de contrôle réglementaires. Dans ce contexte, l’Anses a réalisé un état des lieux inédit des données disponibles sur la contamination par les PFAS en France.
Trois stratégies de surveillance
Des mesures ont été réalisées dans divers compartiments : eaux destinées à la consommation humaine, eaux environnementales, sédiments, biotes (ensembles des organismes vivants présents dans un écosystème spécifique), aliments, air, poussières intérieures et extérieures, sols, matrices biologiques humaines (sang, urine, lait maternel, etc.) et produits de consommation (cosmétiques, textiles, etc.). Ces travaux ont permis d’estimer les niveaux de concentration des PFAS dans l’ensemble des compartiments. Concernant les données de biosurveillance, les niveaux moyens de PFAS mesurés dans le sang de la population française sont inférieurs aux rares seuils existants (PFOS, PFOA), et sont comparables aux niveaux mesurés en Europe.
Les résultats conduisent l’Anses à proposer trois stratégies de surveillance :
– surveillance pérenne : pour les substances les plus préoccupantes et récurrentes dans le cadre des plans de surveillance nationaux,
– surveillance exploratoire, réalisée ponctuellement : pour les substances pas ou insuffisamment recherchées aujourd’hui,
– surveillance localisée : pour des substances correspondant à des sources de contaminations locales avérées ou suspectées, que les contaminations soient anciennes ou actuelles.
Il appartiendra aux pouvoirs publics et aux acteurs en responsabilité (employeurs, responsables d’activités émettrices ou utilisatrices, etc.) d’adapter leurs stratégies de surveillance au regard de ces recommandations.
 Se connecter
Se connecter